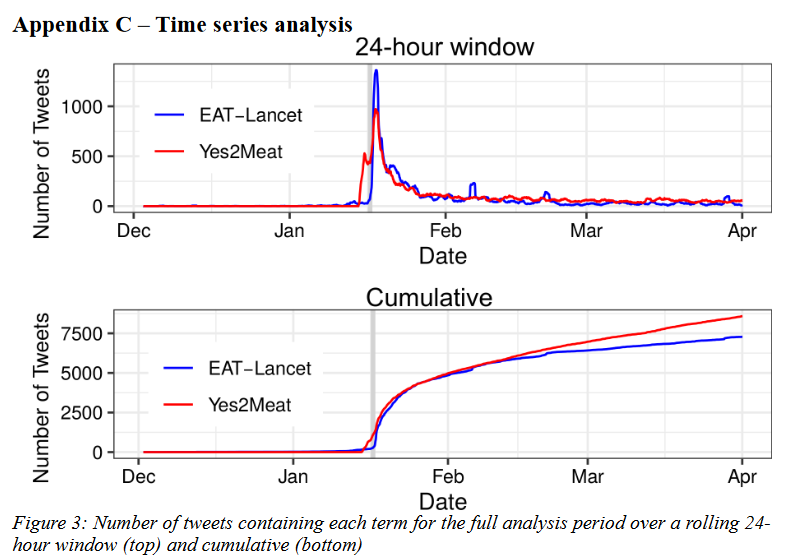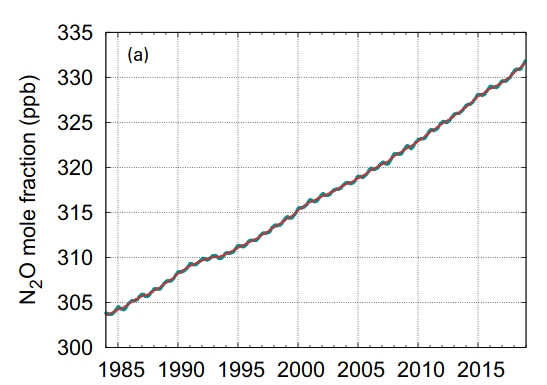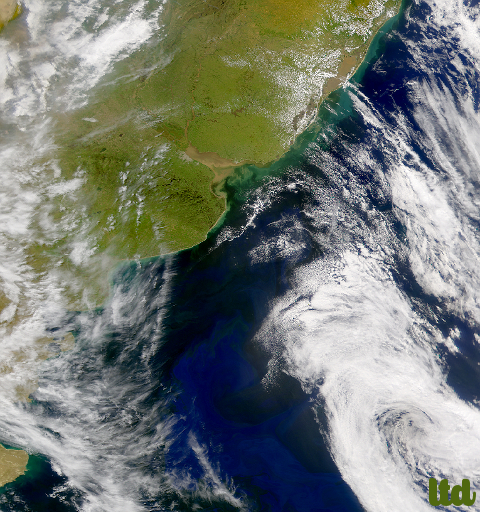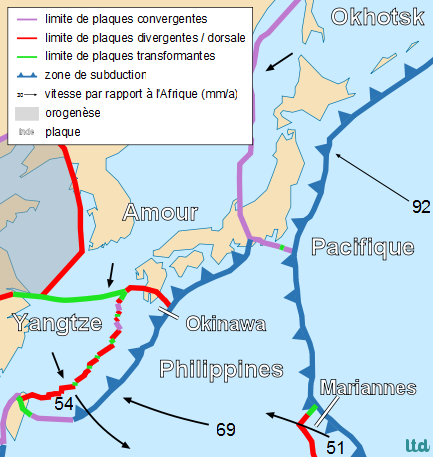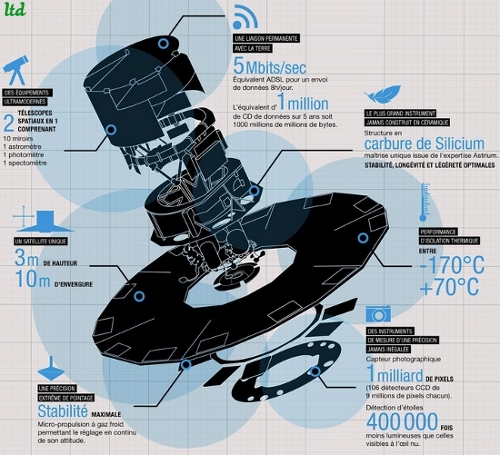Voici une représentation de la déesse Kali, qui dans la culture hindouiste représente la destruction. Mais elle était auparavant une déesse-mère et il y a beaucoup de choses à comprendre du rapport entre les femmes et le véganisme, entre le féminisme et la défense des animaux.

Le mouvement pour la défense des animaux est féminin dans sa
très grande majorité. Il est composé surtout de femmes, il est
porté par des femmes, il a été porté par des femmes à l’origine.
Bien entendu, il y a des hommes. Mais en ce qui concerne la question
des animaux, ce sont toujours les femmes qui donnent le ton.
C’est l’image inversée des chasseurs. Il y a des femmes qui
participent au mouvement de la chasse dans son ensemble, mais ce sont
les hommes qui donnent le ton. Ce sont eux qui façonnent la
tradition, la culture, les valeurs.
Partant de là, il faut choisir entre les deux… et on voit bien
que c’est le féminisme qui ressort de cette confrontation. Car
même si les femmes sont pacifiques (ce qui ne veut pas dire qu’elles
ne sont pas capables de violence), face aux hommes et leur brutalité,
leur style guerrier, chasseur…. Il n’y a pas le choix, il y a
conflit.
Du point de vue concret, au-delà de ce conflit, il y a dans la
défense des animaux une dimension féminine du refus de
l’affirmation viriliste au profit du travail concret, pacifique.
Les hommes qui participent au mouvement doivent s’y plier, ou partir… ou plus exactement, ils ne sont même pas attirés, parce que le travail concret ne laisse pas d’espace pour faire le malin, pour se mettre en avant, etc.

Il y a toute une soumission qui est demandée à la cause quand on
travaille pour les animaux… Cette soumission est insupportable pour
les machos croyant tout savoir ou même les femmes égocentriques
privilégiant leur petite affirmation individuelle.
Cela n’est vrai bien entendu que pour le mouvement pour la
défense des animaux plaçant ces derniers au cœur de leur vision du
monde. La scène « antispéciste » ne fonctionne pas du
tout pareillement, même si les femmes y sont un moteur. Le côté
« anti » permet tout et n’importe quoi, empêche la
formation d’une réelle culture et donc toutes les dérives…
Toutes les dérives.
D’ailleurs, les « antispécistes » ne sont pas
intéressés par l’écologie, alors que pour les femmes du
mouvement pour la défense des animaux, c’est un thème considéré
comme évidemment parallèle.
Le meilleur symbole du rapport entre la défense des animaux et le féminin, ou le féminisme d’ailleurs, c’est sans aucun doute la déesse-mère. Les petites statuettes datant du Paléolithique représentent la femme comme la déesse du monde : la femme est associée à la Terre, à la vie, au sens de la vie elle-même. La statuette la plus connue est celle de Willendorf, en Autriche, datant de plus de 22 000 ans.

La statuette de Galgenberg, encore en Autriche, a plus de 32 000 ans.

Il y en a beaucoup d’autres exemples et on trouve également les
traces de ces déesses-mères dans les premières religions, où
elles sont intégrées de manière subalterne. Ce sont les Astarté,
Ishtar, Aphrodite, Déméter Parvati, Kali… et bien sûr, Gaïa.
Voici encore un exemple avec la statuette qu’on appelé La Dame aux léopards, qui a été trouvée en Anatolie et date de huit mille ans avant notre ère.

Ces déesses-mères ont été renversé par le Dieu patriarcal,
mécontent et massacreur. Ce renversement se déroule parallèlement
au triomphe de l’agriculture et de l’élevage, autrement dit de
l’activité humaine contre la Nature.
Or, le seul projet valable pour l’humanité, c’est de cesser
cette guerre contre la Nature, de trouver sa place dans la
Terre-mère… Ou bien de retourner en arrière, ce que veulent les
primitivistes.
Ce n’est qu’en considérant la Terre comme une mère que
l’humanité acceptera de se soumettre, de comprendre réellement le
sens de la vie. Les femmes, mises de côté pendant des milliers
d’années par des hommes prenant le dessus dans le prolongement de
leurs activités de chasseurs et de cueilleurs, doivent contribuer à
la transformation totale de l’humanité. Elles le comprennent par
définition, même si c’est de manière totalement aliénée par
des siècles de déformation patriarcale ou, désormais, de
consommation capitaliste effrénée.
La seule orientation possible pour l’humanité, c’est un
abandon de l’élevage, une adaptation de l’agriculture à la
planète (et son recul maximum par rapport à la vie sauvage), une
soumission aux intérêts de la planète afin qu’elle redevienne
bleue et verte.
Les femmes doivent être première ligne dans cette bataille pour les animaux et la Nature, afin de contribuer au premier plan à aller dans la bonne direction.